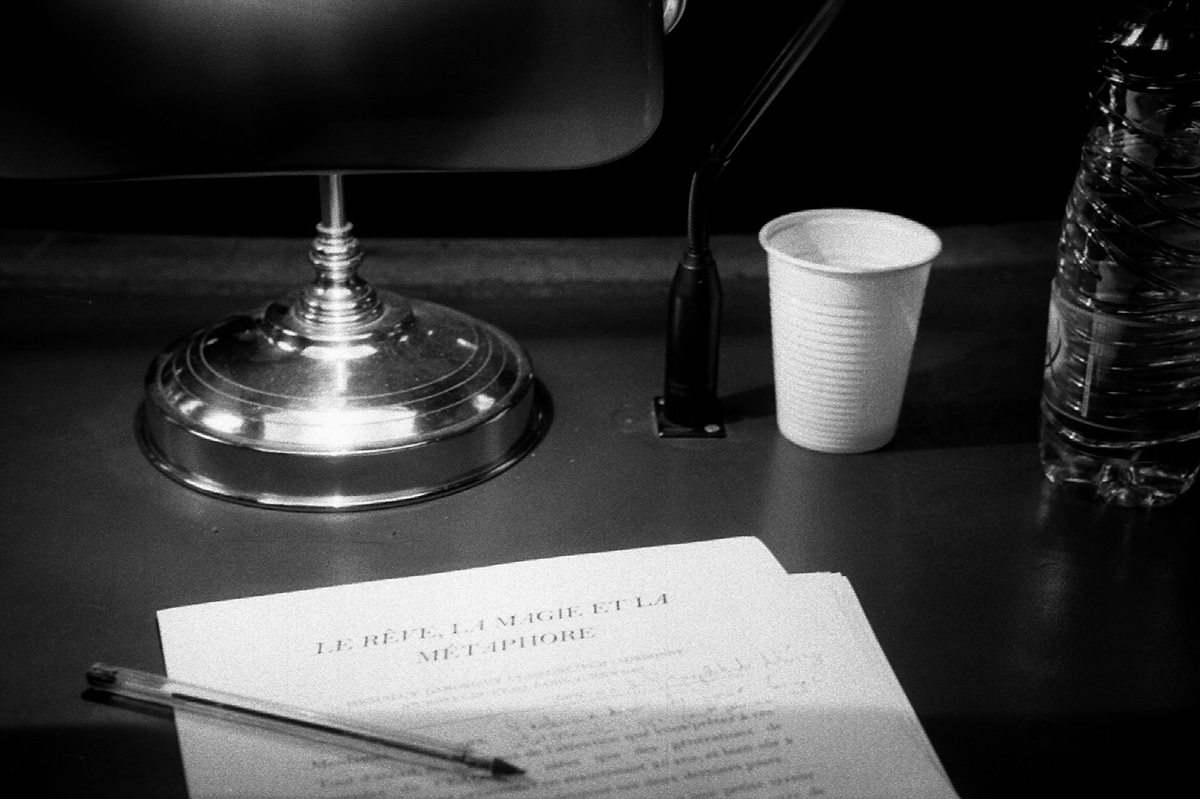Dans la salle Louis Liard, le 21 juin 2007, je devais donner une lecture sur "la technique invisible". Enfin c'est ce qui était écrit sur le papier. Lorsque j'ai la chance de faire une lecture, j'essaie de parler lentement et, au lieu de donner quatre ou cinq idées successives, je cherche à n'en donner qu'une seule, sous la forme de plusieurs variations simples et complémentaires. Tout du moins, c'est le projet.
Un auteur respectable (édité chez Seghers, la maison d'édition d'Aragon), dit un soir, devant l'Hotêl du Terminus, à Cahors, que donner une lecture, c'est donner de l'intelligence aux spectateurs. Je n'étais pas d'accord avec lui, je ne le suis toujours pas. Je pense que donner une lecture, c'est recevoir de l'attention, et que, comme publier un livre, parler est à la fois une chance et une responsabilité. Je ne sais pas comment remercier Julieta Leite, qui me dit il y a quelques jours, c'est à dire trois mois après la lecture qui suit, qu'elle en avait aimé la lenteur, et qu'elle y avait vu, où probablement il n'y a rien, quelque chose d'humain.
C'est donc un photographe qui est aussi chercheur et qui dit :
Mesdames et messieurs,
Tout d’abord, merci à vous de l’attention que vous prêtez à ces journées du CEAQ, aux idées que des générations de chercheurs y ont présentées en maintenant 25 ans, et bien sûr à celles que notre génération a proposé ces deux derniers jours.
Je me suis rendu compte trop tard qu’il y a une petite erreur dans le titre de cette intervention, ou plutôt dans le titre de l’intervention qui est écrit sur le programme. C’est une évidence pour chacun d’entre nous que la technique est partout, qu’elle est un maillon très fort de notre quotidien, et j’ai eu le sentiment que parler de la « technique invisible » pouvait faire penser à un contre-sens ou à un manifeste paranoïaque.
Je vais donc essayer de parler de quelque chose de plus large : du rêve, de la magie et de la métaphore. Et pour ceux qui, d’aventure, resteraient jusqu’au bout de cette intervention, je vais aussi essayer de donner une petite idée sur le devenir de la technique, qui a été élaborée au sein du Groupe d’Etude sur la Technique et le Quotidien, que dirige Stéphane Hugon depuis maintenant 7 ans.
Le rêve de Susca
Et parce que j’ai du mal à conduire un propos sans exemple, je voudrais commencer par le récit d’un rêve. J’aurais voulu que ce rêve fût un rêve de Simmel, ou de Durkheim, ou d’un grand rêveur comme Kafka ou Coleridge, mais c’est un rêve qui est venu à Vincenzo Susca, et comme c’est un très beau rêve, je pense que nous pouvons le lui pardonner.
Donc Susca fait un rêve. Il se réveille et il se souvient d’une phrase très précise. Il sait que cette phrase était précédée par des architectures gigantesques, des protagonistes multiples et une longue suite d’événements, mais, lorsqu’il se réveille, il ne se souvient que de cette phrase mystérieuse. La phrase est « la chronique est plus importante que la beauté ». Vincenzo Susca rêve en italien, et donc la phrase lui vient en italien, mais la traduction est celle-ci : « la chronique est plus importante que les beauté ».
Susca est certain que cette phrase veut dire quelque chose, qu’elle a un sens caché, ou si vous voulez, il garde l’impression rêvée que cette phrase a un sens, mais, maintenant qu’il est réveillé, il est tout aussi certain que ce sens est perdu, et ce qui lui reste, ce sont des hypothèses.
Il y a deux possibilités. Soit cette phrase est fausse, et c’est une perversion ou un assemblage hasardeux (enupnion), et elle ne veut rien dire. C’est un don, ou une pure invention de l’esprit, pour reprendre une vieille idée d’Homère et de Virgile1. Mais nous pensons à mille exemples de la littérature, où l’expérience poétique (ou le sentiment poétique) se produit de manière naturelle et inévitable, et où nous l’acceptons justement parce que le récit le justifie et que la musicalité d’une phrase, ou une métaphore merveilleuse sont causés par une circonstance ou un lieu.
Alors cette phrase est vraie, ou prophétique (oneiros), et la chronique est effectivement plus importante que la beauté. Mais cela n’est pas possible, parce qu’il existe au moins une structure narrative où la chronique est nettement moins importante que la beauté, où le spectateur croit pleinement à ce qui lui est raconté, même si la chronique des événements est décousue. Et en échange de son implication, il reçoit l’inspiration, des images surprenantes, il rencontre des personnages inattendus, il entend des phrases à tiroir, et cette structure c'est le rêve.
Parce que dans le rêve, nous acceptons quotidiennement qu’une image nous porte à une autre image, sans pour autant qu’entre ces deux images la logique ou l’étymologie puisse trouver un lien.
Bien sûr, il existe des précis d’onirologie, d’onirocritique, et d’oniromancie. Au terme de ses voyages, je crois qu’Artémidore d’Ephèse2 basait ses prédictions sur un corpus de plus de 3000 rêves. Mais, quand nous rêvons aujourd’hui, nous ne pensons pas que le rêve nous porte une image de l’avenir, nous acceptons les images qui nous sont offertes, et lorsqu’elles nous reviennent au cours de la journée, le lien qu’elles entretiennent les unes avec les autres, leur association, nous paraissent étrangement justifiés.
La métaphore et le trajet de A à B
Si vous voulez trouver un exemple de structure narrative similaire dans la poétique, ou dans la linguistique, vous pouvez penser à la métaphore. Dans une métaphore, comme dans le rêve, deux images ou deux formes sont associées l’une à l’autre, et le spectateur ou le lecteur sent cette association, ressent cette association, mais il lui est impossible de retracer le trajet qui lie les deux mots, ou de le retracer mécaniquement.
Si nous pensons aux grandes métaphores de la littérature, aux métaphores qu’ont employés les chinois, les grecs, les saxons et qui sont aussi nos contemporaines, nous trouvons la métaphore qui lie la lune à un miroir, les étoiles aux yeux ou encore l’homme à une carte de l’univers. Caldéron, par exemple, pensait que l’homme est un univers en miniature. Il a aussi un vers où, pour parler d’un pistolet, il dit « un aspic d’argent ». Cette autre métaphore est aussi très ancienne, celle qui compare le métal à la mort : quelque part dans l’Odyssée il est question d’un sommeil d’acier, et lorsque la seconde des filles traîtresses du roi Lear décrit son amour, elle dit qu’il est forgé « dans le même métal » que sa sœur, la première traîtresse. Le lecteur comprend que le présage est funeste et que l’amour est déjà mort.
Devant chacune de ces métaphores, le lecteur ou le spectateur sent une liaison intime entre deux choses a priori étrangères, et un émerveillement devant l’impossibilité de raisonner ce lien, de le dissoudre, de le décomposer.
La magie et la technique moderne
Et si nous cherchons une forme sociale correspondant au rêve et à la métaphore, il nous suffit de penser à la magie.
Pas la prestidigitation, le cas de la prestidigitation est un peu particulier, puisque nous pensons qu’il y a un truc, nous sommes persuadés qu’il y a un truc. Si nous ne l’étions pas, nous demanderions une enquête scientifique sur le tour et une biopsie du magicien, pour que chacun puisse bénéficier de son pouvoir magique.
Je pense ici à la magie telle que la craignait par exemple le 19e siècle de l’Abbé Migne, et qui est une manière de produire des effets merveilleux à partir de causes naturelles. Ce qui caractérise l’effet merveilleux, c’est justement l’impossibilité de le raccrocher à une chronique d’événements.
L’idée que ce lien échappe à l’entendement, ou à la vue, ou aux nombreuses méthodes scientifiques qui se sont succédées et qui ont prouvé la fausseté de la méthode précédente, est proprement le cauchemar de la modernité. Pour reprendre un mot que Heidegger dit en 1953 ou 1954 dans une conférence3, La technique moderne est un mode du dévoilement, une provocation la nature, elle la met en demeure de livrer ses forces et produit des bobines et des engrenages pour la canaliser et l’accumuler.
La technique moderne est bien représentée par cette image des rouages laborieux, qui relaient et acheminent une énergie vers un destin ingénieux. Ce fantasme du découpage et du caractère prédictif des événements, jusqu’aux paradigmes déterministes les plus audacieux, ont gouverné la science du 19e siècle, cette fois celui du démon de Laplace4, qui est cette créature philosophique qui connaîtrait l’état de l’univers et pourrait prévoir ses états futurs et retrouver ses états passés. Le même fantasme n’était pas absent des espoirs d’Artémidore, dont les prédictions étaient si hasardeuses, qu’il arrivait même qu’elles se réalisent.
Nos générations, qui connaissent bien la modernité, qui ont lu ses livres, gardent un lien très fort avec l’image des rouages, de la machinerie mécanique. J’aime beaucoup cette expression du professeur Maffesoli. Lorsqu’il parle d’un type de connaissance évidente, il dit que nous savons certaines choses parce que nous les avons bues « avec le lait de la mère ». Et bien nous savons, de cette manière-là, que les forces qui animent une montre mécanique sont à notre mesure, que, si nous avions le temps, et de bons yeux, nous pourrions remonter chacune des roues qui vont du ressort jusqu’aux aiguilles et comprendre, par le seul exercice de la logique, le fonctionnement d’un appareil mécanique quelconque.
La technique invisible
Mais si vous faites tomber votre téléphone portable dans l’eau, ou si, un jour, l’ordinateur ne s’allume plus, si l’imprimante est reconnue le lundi, mais pas le mardi, ni le mercredi, vous vous trouvez dans une situation en même temps nouvelle et archaïque. Nouvelle parce que cela fait des années que l’idée de la dysfonction était associée à une cause mécanique, et que, malgré sa complexité, cette cause était toujours à notre mesure, ce qui n’est pas le cas des pannes électroniques.
Archaïque, parce que vous vous trouvez devant une machine qui n’est pas au-delà de la précision de vos sens, comme l’étaient la montre ou l’appareil photo, mais qui est d’une certaine manière inaccessible, qui ne parle ni le langage de vos yeux, ni celui de vos mains, et dont la complexité n’est pas dans le nombre d’éléments qui composent l’engrenage, ou dans leur taille, mais dans le mode de fonctionnement même. Si bien que malgré notre confiance dans les spécialistes, les réparateurs, les experts, la technique qui nous entoure et son mode de fonctionnement échappent à notre regard et à notre capacité immédiate de la comprendre.
J’ai entendu certaines personnes, à ce sujet, parler de technique invisible. Et je trouve qu’ils ont eu un bon mot, parce que ce qui est invisible est présent, parmi nous, mais aussi, d’une certaine manière nous échappe. Il y a dans l’invisible une forme de présence évidente mais inaccessible. J’ai entendu aussi parler de technique magique, de technomagie, ou d’autres manières de lier la technologie avec la magie. Ces phrases, bien entendu, sont des métaphores.
Mais elles rappellent bien que les mythes et les images collectives pénètrent dans la culture et dans l’imaginaire par la relation quotidienne avec un climat, une géographie ou une technologie. Une civilisation dont la technologie est suffisamment avancée est la magie de la civilisation suivante croyait l’écrivain Arthur C. Clark5. Notre civilisation, ajouta-t-il dans un essai ou un roman, est peut-être la première aux yeux de laquelle sa propre technologie est devenue magique.
L'esthétique
J’aimerais dire un dernier mot sur les conséquences de ce lien entre magie et technique, ou entre la structure de pensée que partagent le rêve, la magie, la métaphore et la technique qui nous entoure.
Maintenant que cette structure de pensée est revenue, maintenant que le vocabulaire de l’enfance, le ludique auxquels nous rend souvent attentif l’œuvre du Professeur Maffesoli, comme l’émerveillement, ont été portés jusqu’à nous par la technique, dont le projet même était de purger ces fantasmes et ces enfantillages, je me demande dans quelles autres situations, étrangères à la technique, ou liées à elle métaphoriquement, allons-nous mobiliser ces idées ? Qu’allons-nous penser (malgré nous) à l’aide des cette manière de penser ?
Il faudra passer un peu de temps sur l’intuition de Stéphane Hugon, autour de laquelle, d’ailleurs, s’articuleront les travaux du GRETECH de l’année prochaine. Stéphane nous propose de penser à l’esthétique, et cela m’a amené à cette belle idée d’une réconciliation entre un mode de jouissance qui a besoin d’une présence totale, de l’ordre de la révélation, et un autre mode de jouissance, plus proche de nous, qui fait avec la partialité, le voyage, l’a-peu-près, une manière de jouir de l’insaisissabilité des choses.
Il y a cette phrase, qui a été écrite en 1945 ou 1946, à la fin d’un essai sur la muraille et les livres. Aujourd’hui encore elle me semble très juste. C’est Borges, le jeune Borges (il n’est pas encore aveugle) qui conclut cette petite intervention et qui dit :
« La musique, les états de félicité, la mythologie, les visages travaillés par le temps, certains crépuscules et certains lieux veulent nous dire quelque chose, ou nous l'ont dit, et nous n'aurions pas dû le laisser perdre, ou sont sur le point de le dire ; cette imminence d'une révélation, qui ne se produit pas, est peut-être le fait esthétique. »
1 Virgile (Eneide 6.893) / Homère (Odyssée 19, 562)2 Onirocriticon, Artémidore d'Éphèse, La clef des songes ; trad. et notes par André-Jean Festugière. Paris, J. Vrin, 19753 M. Heidegger, Extraits de Essais et conférences, Trad. André Préau, Paris, Gallimard, 1958, pp. 9 à 48.4 Pierre-Simon Laplace, Essai philosophique sur les probabilités, Paris, Christian Bourgeois, 1986, pages 32 et 33.5 C.f. The Sentinel ou The City and the Stars.